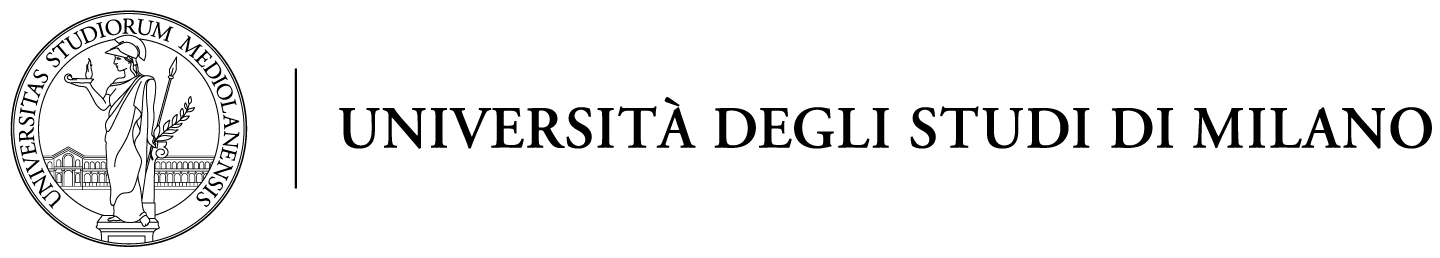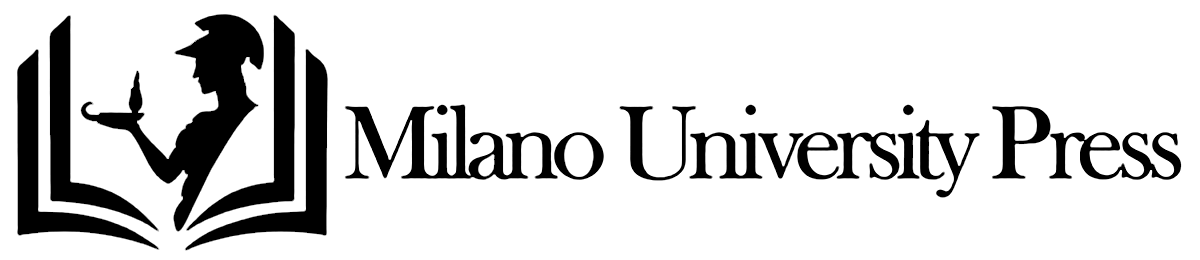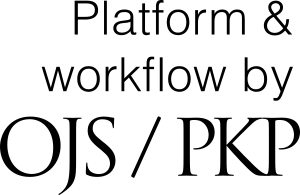La langue et la littérature : des espaces de médiation interculturelle. La force performative de « Kuessipan » de Naomi Fontaine
DOI :
https://doi.org/10.54103/2281-7964/27962Mots-clés :
Médiation interculturelle, Linguistique de l’énonciation, Littérature autochtone, Kuessipan de Naomi FontaineRésumé
Le processus de médiation interculturelle vise à permettre l’échange, la connexion, le dialogue, le rapprochement, la compréhension, la prévention et la résolution des conflits en postulant, comme valeur fondamentale, la possibilité de vivre ensemble avec des différences (Cf. Paola Puccini, Michèle Vatz Laaroussi, Claude Gélinas, La Médiation interculturelle, Milan, Hoepli, 2022, pp. 21-22). Il s’agit donc de construire un pont entre des personnes, des groupes, des institutions qui s’ignorent, ont des préjugés ou se trouvent dans une situation d’incompréhension ou de conflit où la dimension interculturelle est présente, voire prédominante. Nous pensons que la littérature autochtone est particulièrement significative dans sa tentative de dénoncer le racisme, la discrimination, les préjugés, l’exclusion et l’oppression, mais aussi dans sa volonté de dessiner des espaces potentiels pour le développement de la médiation interculturelle. Dans notre travail, nous voulons examiner Kuessipan de Naomi Fontaine avec le désir de montrer sa performativité à travers laquelle l’auteur parvient à créer de nouveaux espaces où elle peut mettre en scène la relation entre les membres d’une communauté et le monde dans lequel ils vivent, générant ainsi une transformation. La pragmatique appliquée au texte littéraire et la théorie linguistique de l’énonciation seront utilisées pour décrire les mécanismes de construction des liens qui se créent au-delà des barrières, des exclusions, des souffrances.
Téléchargements
Références
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Marc ANGENOT, « Que peut la littérature ? Sociocritique littéraire et critique du discours social » in Jacques NEEFS et Marie-Claire ROPARS (dir.), La Politique du texte. Pour Claude Duchet, Lille, Presses universitaires de Lille, 1992.
An ANTANE KAPESH, Je suis une maudite sauvagesse, Montréal, Mémoire d’encrier, [1975] 2021.
Joséphine BACON, Un thé dans la toundra : Nipishapui nete mushuat, Montréal, Mémoire d’Encrier, 2013.
Marie-Christine BLAIS, « Joséphine Bacon : toundra, tu me gâtes » La Presse, 19 décembre 2014, https://www.lapresse.ca/arts/livres/entrevues/201412/19/01-4829639-josephine-bacon-toundra-tu-me-gates.php.
Virginia Pésémapéo BORDELEAU, Ourse bleue, Lachine, Pleine Lune, 2007.
Hélène DESTREMPES, « Plurilinguisme et stratégies identitaires da la littérature autochtone d’expression française au Québec », in Robert DION, Hans-Jurgen LUSEBRINK et Janoz RIESZ (dir.), Écrire en langue étrangère. Interférences de langues et de cultures dans le monde francophone, Montréal, Nota Bene, 2002, pp. 395-415.
Marie-Hélène JEANNOTTE, « L’identité composée : hybridité, métissage et manichéisme dans La saga des Béothuks de Bernard Assiniwi, et Ourse bleue de Virginia Pésémapéo Bordeleau », International Journal of Canadian Studies/Revue Internationale d’études Canadiennes, n. 41, 2010, pp. 297-312.
Marie-Hélène JEANNOTTE, « De la voix au papier. Stratégies de légitimation des publications de mythes oraux des Premières Nations au Québec », Mémoires du livre/Studies in Book Culture, vol. 7, n. 2, 2016, pp. 1-26.
Naomi FONTAINE, Kuessipan, Montréal, Mémoire d’encrier, [2011] 2017.
Naomi FONTAINE, « Préface de Naomi Fontaine », in An Antane KAPESH, Je suis une maudite sauvagesse, Montréal, Mémoire d’encrier, [1975] 2021, pp. 5-9.
Claude GÉLINAS, « Les compétences de la personne médiatrice », in Paola PUCCINI, Michèle VATZ LAAROUSSI, Claude GÉLINAS, La Médiation interculturelle, Milan, Hoepli, 2022, pp. 55-62.
Patricia GODBOUT, « Coexistence linguistique, translinguisme et autotraduction dans quelques œuvres autochtones canadiennes », in Fabio REGATTIN (dir.), Autotraduzione. Pratiche, teorie, storie, Città di Castello, I libri di Emil, 2020, pp. 57-67.
Gabriela GRIGOROIU, « Tradition orale et visions autochtones du monde : la narration orale, une pratique interculturelle d’expression et d’apprentissage partagé ». La Revue de l’AQEFLS, vol. 32, n. 1, 2016, pp. 59–75.
Sarah HENZI, « Stratégies de réappropriation dans les littératures des Premières Nations », Studies in Canadian Literature/Etudes en littérature canadienne, vol. 35, n. 2, 2010, pp. 76-94.
Isabella HUBERMAN, « ‘Garder nos yeux dans l’espoir’ : une entrevue avec Naomi Fontaine », Littoral, n. 11, 2026, pp. 79-82.
Ana KANCEPOLSKY et René LEMIEUX, « Traduire le genre dans Je suis une maudite sauvagesse d’An Antane Kapesh », Les Cahiers Anne Hébert, n. 18, 2022, pp. 70-86.
Dominique MAINGUENEAU, Éléments de linguistique pour le texte littéraire, Paris, Bordas, 1990.
Dominique MAINGUENEAU, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, Dunod, 1997.
Peggy PACINI, « L’Autotraduction chez Grégoire Chabot : médiation, transmission, survie d’une communauté et d’une littérature de l’Exiguïté », in Christian LAGARDE (dir.), « L’autotraduction : une perspective sociolinguistique », Glottopol, n. 25, 2015, pp. 163-177.
Paola PUCCINI, Michèle VATZ LAAROUSSI, Claude GÉLINAS, La Médiation interculturelle, Milan, Hoepli, 2022.
Paola PUCCINI, Anne TREPANIER, Territoire et rencontres interculturelles. En conversation avec Naomi Fontaine et Emmanuelle Dufour, Université de Bologne, Bologne 13 mars 2024.
Myriam SUCHET, L’Imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues, Paris, Classiques Garnier, 2014.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
La revue Ponti/Ponts n’exige pas la cession du droit d’auteur, les auteurs gardent donc tous les droits concernant le contenu de leurs travaux.
La présentation rédactionnelle et l’agencement graphique des travaux publiés en version papier et/ou électronique restent la propriété exclusive de la maison d'édition.
Toute publication ultérieure devra citer les références bibliographiques complètes et la URL de la première édition.
Les publications ultérieures ne pourront pas reprendre l’agencement graphique de la première publication parue sous la marque LED, ni utiliser ou reproduire les fichiers PDF publiés sur le site de la revue. La nouvelle publication ne pourra ni empêcher ni limiter la publication, distribution ou utilisation commerciale du texte, papier ou électronique, de la part de LED.